Le nouveau film de Jacques Doillon a un côté slow burn dont j'imagine qu'il peut décourager pas mal de monde. Il peut pourtant finir par faire de sacrées étincelles. Si le duel oral peine à (me) convaincre totalement - sans le trouver honteux sous prétexte qu'il ne sonne pas "quotidien" -, le tâtonnement des séances physiques permet peu à peu des élans plus qu'inaccoutumés, voire inouïs (un ultime moment-clé en particulier me sidère).
Chez David Cronenberg, je croise souvent des femmes qui ont profondément une longueur d'avance - qu'elles le formulent ou non - sur les (anti-)héros (qui passent certains films à tenter de les rejoindre, parfois avec "succès"), et c'est une des joies peu communes que je trouve aux histoires qu'il choisit de raconter. Je n'ai récemment vu que La Vénus à la fourrure - autre joute aux dialogues à double piqûre - de Polanski qui s'y risque.
Mes Séances de lutte ne s'intéresse pas à Vénus (ni aux dérivés de Sacher-Masoch d'ailleurs) et la force/intuition première de la femme ne nous renvoie pas non plus à des imaginaires type "l'insondable mystère féminin". C'est beaucoup plus humain-très-humain que ça et c'est ce qui achève d'émouvoir, tant le pari, si simple soit-il, est finalement peu tenté.
Le film tente d'ailleurs énormément, comme ses personnages, ce qui (me) fait beaucoup de bien. Et si la grâce n'est donc pas toujours au rendez-vous des dialogues, elle l'est souvent concernant la mise en scène : il suffit de repenser à l'incapacité généralisée de filmer des scènes dansées ces dernières années pour remercier Jacques Doillon de l'intensité préservée de ces riches corps à corps. Remarquable travail de James Thierrée et Sara Forestier, je les trouve magnifiques !
***SPOILERS***
On dirait que le film de Doillon exauce le "vœu" de Jennifer O'Neill à la fin de L'Innocent de Visconti de voir les hommes accepter que les femmes marchent simplement côte à côte avec eux sur la terre (libérés de la dialectique piédestal/humiliation). Alors on peut se sentir sortir d'un tel film vaincu et victorieux à la fois. Plus exactement : désarmé et solaire. Comme l'éclat de rire de ce jeune couple dans son fragile mais heureux triomphe. Triomphe de l'amour : juste un homme, juste une femme, certes pas n'importe lesquels, et qui se trouvent, et pour de bon, chacun s'étant littéralement coltiné l'autre (devant évidemment surtout se coltiner soi via l'accompagnement nécessaire de l'autre). Du possible. Egalité et altérité comme... presque jamais au cinéma. Match tout sauf nul.
Avant-goût d'un entretien que j'aime bien avec Jacques Doillon :
"Peu de scènes et peu de personnages... Mis à part quelques discussions avec la sœur ou une amie, tout est centré sur le cœur des scènes entre «elle» et «lui»...
Quand je vois ces films qui contiennent tellement de scènes qu’elles fonctionnent comme des petits bouts de bande annonce, avec des dialogues d’une grande pauvreté, juste nécessaires et suffisants pour passer à la scène suivante... Un film, c’est très court, on est plus proche de la nouvelle que du roman, alors si on multiplie les scènes, les personnages deviennent fantomatiques et ne sont plus là que pour faire avancer l’intrigue. Y’a pas besoin de personnages parasites, alors oui, ça se joue au cœur."
"Le terme de «séances», l’obsession de revenir à un moment originel de ce couple au début du film, ses injonctions à lui qu’elle règle ses problèmes avec son père... Vous jouez beaucoup avec les outils de la psychanalyse…
Je ne suis pas du côté «des idées» mais du côté des sentiments... «Il n’y a pas de chair dans les idées», écrivait Cézanne... Mon cinéma est bien plus animal que ça, moins réfléchi. Ce qui m’intéresse, c’est d’essayer de renifler au mieux chaque personnage. Bizarre cette image de cinéaste intellectuel qu’on me refourgue sans cesse. Je filme des sentiments, des sensations, des émotions... Je ne suis pas passionné plus que ça par la psychanalyse, j’ai fait des études médiocres et j’ai jamais lu plus de trois lignes de Lacan, je suis un plouc ! J’ai grandi avec Gary Cooper, ça doit s’entendre..."
"On ne peut pas dire que ce sont des dialogues de tous les jours... ?
Je suis pas mécontent d’écrire moins pauvrement et d’essayer de mettre des mots au plus juste sur des sentiments, des sensations. Ce que j’entends dans de nombreux films ou dans le métro, c’est pas des dialogues pour moi, en tous cas pas pour les personnages que j’écris. Les dialogues de nombreux romans anglo-saxons, de Saul Bellow à Richard Ford, et de beaucoup d’autres, sont impeccables, drôles et vraiment singuliers... C’est pas littéraire parce qu’ils écrivent des romans ? Et chez moi ça l’est parce que je suis qu’un cinéaste ? Un rythme aussi vif avec des répliques si choisies, ça pourrait se jouer comme ça dans notre vie ? La réponse est non, on le sait bien... Je ne prétends pas faire des films aussi réalistes que ça, et les dialogues des docu-fictions n’ont jamais excité mon imagination. La vraie question est peut-être ailleurs : s’agit-il de conversation ou ces mots sont-ils les meilleurs outils pour que les luttes amoureuses prennent corps ?"
Un autre film de Doillon évoqué sur ce blog : Le Premier venu

















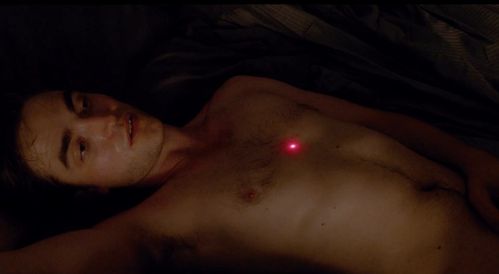








/image%2F1541206%2F20160101%2Fob_38208c_25images-d-d-2009.jpg)

























/idata%2F1171724%2F2014%2FLes-Combattants--Affiche-France-.jpg)
/idata%2F1171724%2F2003%2F28-Days-later--Affiche-US-.jpg)
/idata%2F1171724%2F2013%2FThe-Counselor--Teaser-US-.jpg)
/idata%2F1171724%2F2002%2FDonnie-Darko--Affiche-US-.jpg)
/idata%2F1171724%2F2012%2FHanezu-no-tsuki--Affiche-Japon-.jpg)
/idata%2F1171724%2F2001%2FEloge-de-l-amour--Affiche-France-.jpg)
